
- Détails
- Écrit par David Sicé
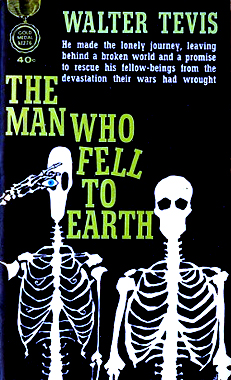
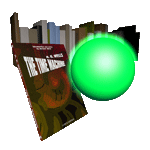
The Man Who Fell To Earth (1963)
Traduction du titre : L'homme qui tomba sur (la planète) Terre.
Sorti aux USA en 1963 chez Gold Metal Books.
Sorti en France en 1973 chez Denoël (poche), traduction de Nicole Tisserand.
Adapté en film en 1976.
Rebooté en série télévisée woke en 2021.
De Walter Tevis.
(presse, extraterrestre) Thomas Jerome Newton est un extraterrestre humanoïde venu sur Terre pour chercher à construire un vaisseau spatial afin de transporter d'autres personnes depuis sa planète natale, Anthea, vers la Terre. Anthea connaît une terrible sécheresse à la suite de nombreuses guerres nucléaires, et la population est tombée à moins de 300 habitants. Leurs propres vaisseaux spatiaux sont inutilisables par manque de carburant et 500 ans de guerre. Les Anthéens n'ont plus d'eau, des réserves de nourriture qui diminuent lentement et une faible énergie solaire. Comme tous les Anthéens, Newton est doté d'une super intelligence, mais il a été sélectionné pour cette mission car il a la force physique nécessaire pour évoluer dans le climat plus chaud de la Terre et sa gravité plus élevée.
Arrivé sur Terre dans une capsule de sauvetage, Newton atterrit d'abord dans l'État du Kentucky. Il se familiarise rapidement avec l'environnement et élabore un plan. Utilisant la technologie de pointe de sa planète natale, Newton fait breveter de nombreuses inventions et accumule une richesse incroyable à la tête d'un conglomérat technologique. Il prévoit d'utiliser cette richesse pour construire des véhicules spatiaux pour le reste de la population anthéenne.
En chemin, il rencontre Betty Jo, qui tombe amoureuse de lui. Ils se côtoient, malgré le fait que les sentiments de Newton ne soit pas réciproques. On rencontre aussi l'étrange Nathan Bryce, qui dirige son entreprise dans l'ombre. Betty Jo présente à Newton de nombreuses coutumes de la Terre, telles que la religion, la mode et la boisson. Cependant, son appétit pour l'alcool entraîne rapidement des problèmes, car il commence à ressentir des émotions intenses, alors inconnues des Anthéens.
*
Le texte original de Walter Tevis (1963, Gold Medal).
1985: Icarus descending
Chapter One
AFTER TWO MILES of walking he came to a town. At the town’s edge was a sign that read HANEYVILLE : POP. 1400. That was good, a good size. It was still early in the morning — he had chosen morning for the two-mile walk, because it was cooler then — and there was no one yet in the streets. He walked for several blocks in the weak light, confused at the strangeness — tense and somewhat frightened. He tried not to think of what he was going to do. He had thought about it enough already.
In the small business district he found what he wanted, a tiny store called The Jewel Box. On the street corner nearby was a green wooden bench, and he went to it and seated himself, his body aching from the labour of the long walk.
It was a few minutes later he saw a human being.
It was a woman, a tired-looking woman in a shapeless blue dress, shuffling towards him up the street. He quickly averted his eyes, dumbfounded. She did not look right. He had expected them to be about his size, but this one was more than a head shorter than he. Her complexion was ruddier than he had expected, and darker. And the look, the feel, was strange — even though he had known that seeing them would not be the same as watching them on television.
Eventually there were more people on the street, and they were all, roughly, like the first one. He heard a man remark, in passing, “… like I say, they don’t make cars like that one no more,’ and, although the enunciation was odd, less crisp than he had expected, he could understand the man easily.
*
La traduction au plus proche.
1985 : La descente d'Icare
Chapitre 1
APRÈS TROIS KILOMÈTRES de marche, il arriva à une ville. A l’entrée de la ville se trouvait un panneau indiquant HANEYVILLE : POP. 1400. C'était bien, une bonne taille. Il était encore tôt le matin — il avait choisi le matin pour sa marche de trois kilomètres, parce qu'il faisait plus frais — et il n'y avait encore personne dans les rues. Il marcha le long de plusieurs pâtés de maisons dans la faible lumière, troublé par l’étrangeté, tendu et quelque peu effrayé. Il essaya de ne pas penser à ce qu'il allait faire. Il y avait déjà assez pensé.
Dans le petit quartier des affaires, il trouva ce qu'il voulait, un petit magasin appelé La boîte à bijoux. Au coin de la rue voisine se trouvait un banc en bois peint en vert, il s'y dirigea et s'assit, son corps endolori par l’effort de la longue marche.
Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il vit un être humain.
C'était une femme, une femme à l'air fatigué dans une robe bleue informe, qui se dirigeait vers lui en traînant les pieds dans la rue. Il détourna rapidement les yeux, abasourdi. Elle n'avait pas l'air normale. Il s'était attendu à ce qu'ils fassent à peu près sa taille, mais celui-ci était plus petit que lui d'une tête. Son teint était plus rougeaud qu'il ne l'avait imaginé, et plus foncé. Et l'aspect, la sensation, était étrange —même s'il s’était douté que les voir ne serait pas la même chose que de les regarder à la télévision.
Finalement, il y eut d'autres personnes dans la rue, et elles étaient toutes, en gros, comme la première. Il entendit un homme dire, en passant, "... comme je le disais, ils ne font plus de voitures comme celle-là", et, bien que l'énonciation soit étrange, moins claire que ce à quoi il s'attendait, il pouvait comprendre l'homme facilement.
*
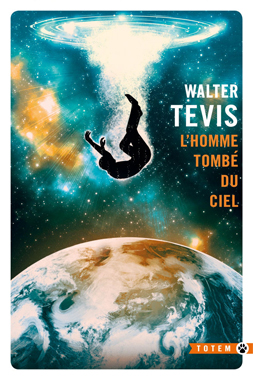
La traduction de Nicole Tisserand (1973).
1985 : LA CHUTE D’ICARE
I
APRÈS TROIS KILOMÈTRES de marche, il arriva à une ville. A la frontière, un panneau indiquait : Haneyville, 1 400 habitants. C’était bien, c’était une bonne taille. Il était encore tôt — il avait choisi de faire ces trois kilomètres à pied pendant la matinée car il faisait plus frais, et les rues étaient encore désertes. Il en traversa quelques-unes dans le petit jour blafard, dérouté par cette étrangeté, tendu et légèrement effrayé. Il essaya de ne pas penser à ce qu’il allait faire. Il y avait déjà suffisamment réfléchi.
Dans le petit quartier commerçant, il trouva ce qu’il cherchait : une minuscule boutique appelée La Boîte à Bijoux. Non loin de là, au coin de la rue, il y avait un banc de bois vert où il alla s’asseoir, le corps endolori par la longue marche qu’il venait d’accomplir.
Quelques minutes plus tard, il vit un être humain.
C’était une femme, une femme à l’air fatigué vêtue d’une robe bleue informe qui se dirigeait vers lui en traînant les pieds. Il détourna rapidement les yeux, sidéré. Il y avait en elle quelque chose qui n’allait pas. Il s’attendait à ce qu’elle soit à peu près de la même taille que lui, mais il dépassait celle-ci de plus d’une tête. Son teint était plus rougeaud et plus sombre qu’il ne le prévoyait. Et c’était étrange de la voir, de la sentir — même s’il savait déjà que ce ne serait pas pareil de les voir en vrai que de les regarder à la télévision.
La rue s’anima peu à peu, et tous les habitants étaient à peu près comme la première femme. Il entendit un passant dire : « … comme je dis, des voitures comme ça, on n’en fabrique plus » ; et, bien que la prononciation fût bizarre, moins nette qu’il ne se l’imaginait, il comprit facilement.
***
Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacré à ce roman.
***
- Détails
- Écrit par David Sicé

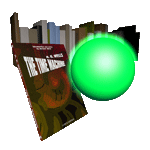
Fantasiestücke in Callots Manier (1814)
Traduction : Fantaisies a la manière de Jacques Callot.
Egalement connu sous le titre "Les contes d'Hoffmann".
Recueilli en 1814 dans le quatrième volume des contes d’E. T. A. Hoffmann, une compilation de nouvelles déjà éditées préalablement.
Notamment traduit en français par Henry Egmont en 1836 chez Béthune et Plon, Paris.
Notamment traduit en octobre 1979 par Henri DE CURZON dans Fantaisies dans la manière de Callot chez PHEBUS FR, réédité chez POCKET FR en 1990.
Notamment réédité le 3 mai 2018 dans Fantaisies dans la manière de (Jacques) Callot chez LIBRETTO FR.
Notamment adapté au théâtre par Jules Barbier et Michel Carré sous le titre Les contes fantastiques d'Hoffmann, première en 1851 à Paris.
Notamment adapté en opérette Jacques Offenbach (musique posthume) et Jules Barbier (texte) sous le titre Les contes d'Hoffmann, première le 10 février 1881 à Paris.
Adapté en film muet sorti en Allemagne le 25 février 1916, en partie perdu.
Adapté en film muet sorti en Autriche le 6 avril 1923.
Le film anglais de 1951 est une adaptation de l’opérette chantée en anglais.
De Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
*
Le texte original de E.T.A Hoffmann (1814)
Die Geschichte vom verlornen Spiegelbilde.
Endlich war es doch so weit gekommen, daß Erasmus Spikher den Wunsch, den er sein Leben lang im Herzen genährt, erfüllen konnte. Mit frohem Herzen und wohlgefülltem Beutel setzte er sich in den Wagen, um die nördliche Heimath zu verlassen und nach dem schönen warmen Welschland zu reisen. Die liebe fromme Hausfrau vergoß tausend Thränen, sie hob den kleinen Rasmus, nachdem sie ihm Nase und Mund sorgfältig geputzt, in den Wagen hinein, damit der Vater zum Abschiede ihn noch sehr küsse. „Lebe wohl, mein lieber Erasmus Spikher,“ sprach die Frau schluchzend, „das Haus will ich Dir gut bewahren, denke fein fleißig an mich, bleibe mir treu und verliere nicht die schöne Reisemütze, wenn Du, wie Du wol pflegst, schlafend zum Wagen herausnickst.“ – Spikher versprach das. –
In dem schönen Florenz fand Erasmus einige Landsleute, die voll Lebenslust und jugendlichen Muths in den üppigen Genüssen, wie sie das herrliche Land reichlich darbot, schwelgten. Er bewies sich ihnen als ein wackrer Kumpan und es wurden allerlei ergötzliche Gelage veranstaltet, denen Spikhers besonders muntrer Geist und das Talent, dem tollen Ausgelassenen das Sinnige beizufügen, einen eignen Schwung gaben. So kam es denn, daß die jungen Leute (Erasmus erst sieben und zwanzig Jahr alt, war wol dazu zu rechnen) einmal zur Nachtzeit in eines herrlichen, duftenden Gartens erleuchtetem Boskett ein gar fröhliches Fest begingen. Jeder, nur nicht Erasmus, hatte eine liebliche Donna mitgebracht. Die Männer gingen in zierlicher altteutscher Tracht, die Frauen waren in bunten leuchtenden Gewändern, jede auf andere Art, ganz fantastisch gekleidet, so daß sie erschienen wie liebliche wandelnde Blumen. Hatte Diese oder Jene zu dem Saitengelispel der Mandolinen ein italienisches Liebeslied gesungen, so stimmten die Männer unter dem lustigen Geklingel der mit Syrakuser gefüllten Gläser einen kräftigen deutschen Rundgesang an. — Ist ja doch Italien das Land der Liebe.
Der Abendwind säuselte wie in sehnsüchtigen Seufzern, wie Liebeslaute durchwallten die Orange und Jasmindüfte das Boskett, sich mischend in das lose neckhafte Spiel, das die holden Frauenbilder, all’ die kleinen zarten Buffonerien, wie sie nur den italienischen Weibern eigen, aufbietend, begonnen hatten. Immer reger und lauter wurde die Lust. Friedrich, der Glühendste vor Allen, stand auf mit einem Arm hatte er seine Donna umschlungen, und das mit perlendem Syrakuser gefüllte Glas mit der andern Hand hoch schwingend, rief er:
„Wo ist denn Himmelslust und Seligkeit zu finden als bei Euch, Ihr holden, herrlichen, italienischen Frauen, Ihr seyd ja die Liebe selbst. – Aber Du, Erasmus,“ fuhr er fort, sich zu Spikher wendend, „scheinst das nicht sonderlich zu fühlen, denn nicht allein, daß Du, aller Verabredung, Ordnung und Sitte entgegen, keine Donna zu unserm Feste geladen hast, so bist Du auch heute so trübe und in Dich gekehrt, daß, hättest Du nicht wenigstens tapfer getrunken und gesungen, ich glauben würde, Du seyst mit einem Mal ein langweiliger Melancholikus geworden.“
— „Ich muß Dir gestehen, Friedrich,“ erwiederte Erasmus, „daß ich mich auf die Weise nun einmal nicht freuen kann. Du weißt ja, daß ich eine liebe, fromme Hausfrau zurückgelassen habe, die ich recht aus tiefer Seele liebe, und an der ich ja offenbar einen Verrath beginge, wenn ich im losen Spiel auch nur für einen Abend mir eine Donna wählte. Mit Euch unbeweibten Jünglingen ist das ein Andres, aber ich, als Familienvater“
Die Jünglinge lachten hell auf, da Erasmus bei dem Worte „Familienvater“ sich bemühte, das jugendliche gemüthliche Gesicht in ernste Falten zu ziehen, welches denn eben sehr possierlich herauskam.
Friedrichs Donna ließ sich das, was Erasmus teutsch gesprochen, in das Italienische übersetzen, dann wandte sie sich ernsten Blickes zum Erasmus und sprach, mit aufgehobenem Finger leise drohend: „Du kalter, kalter Teutscher! – verwahre Dich wohl, noch hast Du Giulietta nicht gesehen!“
In dem Augenblick rauschte es beim Eingange des Bosketts, und aus dunkler Nacht trat in den lichten Kerzenschimmer hinein ein wunderherrliches Frauenbild. Das weiße, Busen, Schultern und Nacken nur halb verhüllende Gewand, mit bauschigen bis an die Ellbogen streifenden Aermeln, floß in reichen breiten Falten herab, die Haare vorn an der Stirn gescheitelt, hinten in vielen Flechten heraufgenestelt. — Goldene Ketten um den Hals, reiche Armbänder um die Handgelenke geschlungen, vollendeten den alterthümlichen Putz der Jungfrau, die anzusehen war, als wandle ein Frauenbild von Rubens oder dem zierlichen Mieris daher.
„Giulietta!“ riefen die Mädchen voll Erstaunen. Giulietta, deren Engelsschönheit Alle überstrahlte, sprach mit süßer lieblicher Stimme: „Laßt mich doch Theil nehmen an Euerm schönen Fest, ihr wackern teutschen Jünglinge. Ich will hin zu Jenem dort, der unter Euch ist so ohne Lust und ohne Liebe.“
Damit wandelte sie in hoher Anmuth zum Erasmus und setzte sich auf den Sessel, der neben ihm leer geblieben, da man vorausgesetzt hatte, daß auch er eine Donna mitbringen werde. Die Mädchen lispelten unter einander: „Seht, o seht, wie Giulietta heute wieder so schön ist!“ und die Jünglinge sprachen: „Was ist denn das mit dem Erasmus, er hat ja die Schönste gewonnen und uns nur wol verhöhnt?“
*
La traduction au plus proche
L'histoire du reflet perdu.
Enfin, Erasmus Spikher put réaliser le désir qu'il avait nourri toute sa vie dans son cœur. Le cœur joyeux et la bourse bien remplie, il s'installa dans la voiture pour quitter sa patrie du nord et se rendre dans la belle et chaude Romanie. La chère et pieuse ménagère versa mille larmes ; après avoir soigneusement nettoyé le nez et la bouche du petit Rasmus, elle le souleva dans la voiture pour que son père l'embrasse encore très fort en guise d'adieu.
« Adieu, mon cher Erasmus Spikher, dit la femme en sanglotant, je te garderai bien la maison, pense bien à moi, reste-moi fidèle et ne perds pas ta jolie casquette de voyage, si, comme tu en as l'habitude, à t’endormir dans la calèche la tête baissée. »
Spikher le promit.
Dans la belle Florence, Érasme trouva quelques compatriotes qui, pleins de joie de vivre et d'un courage juvénile, se délectaient des plaisirs somptueux que leur offrait en abondance ce magnifique pays. Il se révéla être un bon compagnon et toutes sortes de réjouissances furent organisées, auxquelles l'esprit particulièrement vif de Spikher et son talent pour ajouter du sens à l'hilarité donnèrent un élan particulier.
C'est ainsi que les jeunes gens (Érasme, qui n'avait que sept et vingt ans, pouvait bien être compté parmi eux) firent un jour une fête très joyeuse, à la nuit tombée, dans le bosquet illuminé d'un jardin magnifique et odorant. Chacun, à l'exception d'Érasme, avait amené avec lui une charmante dame. Les hommes étaient vêtus d'un délicat costume de l'ancienne Allemagne, les femmes étaient habillées de façon fantastique, chacune d'une manière différente, de sorte qu'elles ressemblaient à d'adorables fleurs ambulantes. Si l'une ou l'autre chantait une chanson d'amour italienne au son des cordes de la mandoline, les hommes entonnaient un chant allemand puissant sous le tintement joyeux des verres remplis de Syracusa. — Après tout, l'Italie est le pays de l'amour.
Le vent du soir murmurait comme des soupirs nostalgiques, les parfums d'orange et de jasmin parcouraient le bosquet comme des sons d'amour, se mêlant au jeu lâche et taquin que les ravissantes figures féminines avaient commencé à offrir, avec toutes les petites bouffonneries délicates qui ne sont propres qu'aux femmes italiennes.
Le désir devenait de plus en plus vif et bruyant. Frédéric, le plus ardent de tous, se leva, enlaçant d'un bras sa Donna, et brandissant de l'autre main le verre rempli de Syracusa pétillante, il s'écria : « Où donc trouver les plaisirs du ciel et la félicité, si ce n'est chez vous, charmantes et splendides femmes italiennes, vous êtes l'amour même.
« Mais toi, Érasme, continua-t-il en se tournant vers Spikher, tu n'as pas l'air de le sentir particulièrement, car non seulement tu n'as invité aucune donna à notre fête, contrairement à tous les rendez-vous, à l'ordre et aux usages, mais encore tu es aujourd'hui si morne et si replié sur toi-même que, si tu n'avais pas au moins bu et chanté courageusement, je croirais que tu es devenu tout à coup un mélancolique ennuyeux.
— Je dois t'avouer, Frédéric, répondit Érasme, que je ne peux pas me réjouir de cette façon. Tu sais que j'ai laissé derrière moi une chère et pieuse ménagère que j'aime profondément, et à laquelle je trahirais manifestement si je choisissais, ne serait-ce que pour un soir, une Donna.
Les jeunes gens éclatèrent de rire, car Érasme, en disant ‘père de famille’, s'efforçait de plisser gravement son visage juvénile et agréable, ce qui le rendait très drôle. La Donna de Frédéric se fit traduire en italien ce qu'Érasme avait dit en allemand, puis, se tournant vers Érasme d'un air grave, elle lui dit, en levant le doigt et en le menaçant doucement : « Froid, froid, Allemand ! Garde-toi bien, tu n'as pas encore vu Giulietta ! »
A cet instant, il y eut un bruit à l'entrée du bosquet, et, sortant de la nuit noire, une vision de femme merveilleuse apparut dans la lueur des bougies. La robe blanche, qui ne couvrait qu'à moitié la poitrine, les épaules et la nuque, avec des manches bouffantes qui descendaient jusqu'aux coudes, formait de larges plis, les cheveux étaient séparés par une raie sur le front et relevés en tresses derrière. — Des chaînes d'or autour du cou, de riches bracelets autour des poignets, complétaient le costume antique de la jeune fille, qui semblait sortir d’un portrait de Rubens ou du gracieux Mieris.
« Giulietta ! » s'écrièrent les jeunes filles avec étonnement.
Giulietta, dont la beauté angélique éclipsait tout le monde, répondit d'une voix douce et suave : « Laissez-moi donc prendre part à votre belle fête, braves jeunes gens allemands. Je veux aller voir celui qui est parmi vous sans plaisir et sans amour. »
Elle se dirigea alors avec beaucoup de grâce vers Érasme et s'assit sur le fauteuil qui était resté vide à côté de lui, car on avait supposé qu'il amènerait aussi une donna. Les jeunes filles zézayaient entre elles : « Regardez, ô regardez comme Giulietta est belle aujourd'hui à nouveau ! » et les jeunes gens disaient : « Qu'est-ce que c'est que cet Érasme, il a gagné la plus belle et il s'est bien moqué de nous ? »
*
La traduction de Henry Hegmont de 1836 pour Béthune et Plon
L’HISTOIRE DU REFLET PERDU
L'heure était enfin arrivée où Érasme Spikher pouvait accomplir le souhait le plus ardent qu'eût nourri son cœur depuis qu'il était au monde. Ce fut ivre de joie, et la bourse bien garnie, qu'il monta en voiture pour quitter le nord, sa patrie, et se rendre dans la chaude et belle Italie. Sa tendre et sensible moitié, noyée dans un torrent de larmes, souleva une dernière fois le petit Rarasme à la portière, après lui avoir essuyé proprement le nez et les lèvres, pour que son père lui donnât les baisers d'adieu, et dit ensuite elle-même en sanglotant : « Adieu ! mon cher Érasme Spikher ! Je veillerai soigneusement sur la maison; pense bien souvent à moi, reste-moi fidèle, et ne perds pas ton joli bonnet de voyage en penchant la tête hors de la voiture, comme c'est ton habitude en dormant. » Spickher promit cela.
Dans la douce Florence, Érasme trouva plusieurs compatriotes, qui, pleins de l'ardeur de la jeunesse et avides des plaisirs de la vie, se livraient à toutes les jouissances faciles et multipliées qu'offre ce pays magnifique. Il fraya avec eux comme un brave et solide compagnon, et l'on organisa mille délicieuses parties auxquelles l'humeur joyeuse de Spikher et son talent tout particulier d'allier une certaine raison aux folies les plus désordonnées, donnaient un attrait tout particulier.
Il arriva donc que nos jeunes gens (Érasme, âgé de vingt-sept ans seulement, pouvait bien prétendre à ce titre) célébraient une fois pendant la nuit, dans un jardin magnifique, et sous un bosquet parfumé et tout resplendissant, un festin des plus joyeux. Chacun, Érasme seul excepté, avait amené avec soi une charmante donna. Les hommes étaient vêtus de l'ancien costume allemand si distingué, les femmes portaient des robes aux couleurs vives et tranchées, taillées la plupart d'une manière capricieuse et fantastique, ce qui les faisait pour ainsi dire ressembler à autant de fleurs éclatantes et douées de la vie. Quand l'une d'elles avait terminé, aux doux accords de la mandoline, quelque romance d'amour italienne, les convives entonnaient, au joyeux cliquetis des verres remplis de vin de Syracuse, une énergique chanson aux refrains allemands. Oh ! l'Italie est réellement le pays favori de l'amour.
La brise de nuit murmurait de langoureux soupirs dans le feuillage embaumé par les douces émanations des jasmins et des orangers; il semblait que de voluptueux accents voltigeassent dans l'air mêlés aux plaisanteries malicieuses et délicates qu'inspirait à ces femmes charmantes le folâtre enjouement dont leur sexe en Italie possède exclusivement le secret.
La joie devenait de plus en plus bruyante et exaltée. Frédéric, le plus bouillant de la troupe, se leva : d'un bras il avait entouré la taille de sa dame, et de l'autre, élevant en l'air son verre rem pli de vin pétillant, il s'écria : « Où peut-on trouver le bonheur et les plaisirs du ciel ailleurs qu'auprès de vous, ravissantes, divines femmes italiennes! Oui, vous êtes l'amour lui-même !
— Mais toi, Érasme ? poursuivit-il en se tournant vers Spikher, tu n'as vraiment pas l'air d'en être convaincu, car outre que tu n'as amené à cette fête aucune dame, contrairement à nos conventions et à tous les usages reçus, tu es encore aujourd'hui tellement triste et préoccupé, que si tu n'avais du moins vaillamment bu et chanté, je croirais que tu as été subitement atteint d'une noire et fastidieuse hypocondrie.
— Je t'avouerai, Frédéric, répartit Érasme, que je ne saurais partager des divertissements de ce genre. Tu sais bien que j'ai laissé derrière moi une bonne et tendre ménagère, que j'aime aussi du plus profond de mon âme, et envers qui je commettrais évidemment une trahison en choisissant une dame, à votre exemple, même pour une seule nuit. Pour vous autres garçons, c'est autre chose ; mais moi, en qualité de père de famille.... »
Les jeunes gens éclatèrent de rire en voyant Érasme, à ce mot de père de famille, s'efforcer d'imprimer à sa physionomie enjouée et juvénile un air de gravité sénatoriale.
La dame de Frédéric se fit traduire en italien ce qu'Érasme venait de dire en allemand ; puis elle se tourna vers lui, et, d'un air sérieux, lui dit en le menaçant de son doigt levé : « Va, prends garde, froid Allemand ! prends bien garde : tu n'as pas encore vu Giulietta. »
En cet instant, un léger frôlement se fit entendre à l'entrée du bosquet, et l'on vit paraître, à la splendeur des bougies, une femme d'une merveilleuse beauté. Sa robe blanche, qui ne couvrait qu'à demi son dos, sa gorge et ses épaules, garnie de manches bouffantes fendues jusqu'au coude, formait autour d'elle mille plis étoffés, et ses cheveux abondants, séparés sur son front, étaient nattés et relevés par derrière. Une chaîne d'or au cou, de riches bracelets complétaient la parure antique de la jeune beauté, qui ressemblait à une Vierge de Rubens ou du gracieux Miéris.« Giulietta ! » — s'écrièrent les jeunes filles avec l'accent de la surprise. Giulietta, dont la beauté angélique les éclipsait toutes, dit d'une voix douce et pénétrante : « Me laisserez-vous prendre part à votre joyeuse fête, jeunes et braves Allemands ? je choisis ma place auprès de celui-ci, qui le seul d'entre vous paraît abattu et le cœur vide d'amour. »
En même temps elle s'avança avec une grâce enchanteresse vers Érasme, et s'assit sur le siège resté vide auprès de lui, par suite de la convention prise entre tous les convives d'amener chacune sa donna. Les femmes chuchotaient entre elles : « Voyez donc, voyez comme Giulietta est encore belle aujourd'hui ! »
Et les jeunes gens disaient : « Que veut dire ceci ? Mais c'est qu'Érasme en vérité a la plus belle part de nous tous, et sans doute il se raillait de nous. »
*
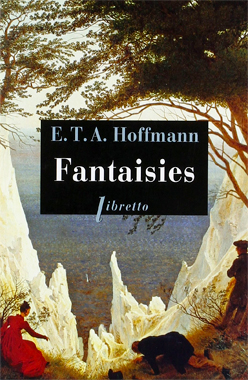
Autres traductions à venir.
***
Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à ce recueil de nouvelles.
***
- Détails
- Écrit par David Sicé

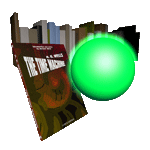
Biggles 1 : The Camel Are Coming 1932
Traduction du titre : (L'escadron) Le Chameau en approche.
Sorti en Angleterre 1932 chez John Hamilton Ltd UK (premier des 99 volumes).
La série Biggle a une partie de ses romans traduits en France à partir de 1946 (Biggles in the South Seas 1940, titre français Corsaires du Pacifique) aux Presses de la Cité FR et Arthaud FR.
The Camel Are Coming 1932 fait partie des titres seulement traduits à partir de 1991 chez Claude Lefrancq BE, compilé dans Biggles l'intégrale volume 1 sous le titre en 2001 chez Ananke BE. J'ignore les noms des traducteurs à cette date vu qu'ils ne sont mentionnés nulle par à ce stade de mes recherches.
Les aventures de Biggles ont également été adaptées
* en bande-dessinées chez Le Lombard, Miklo et Lefrancq
* en une série télévisée Biggles 1960 des studios Granada, 44 épisodes de 30 minutes chaque.
* un film de voyage dans le temps en 1986.
De William Earl Johns.
Pour adultes et adolescents
(aventures) Il s’agit du recueil des premières nouvelles racontant les aventures de Biggles, tout jeune aviateur pendant la première guerre mondiale, inspiré des aventures vécues par W. E. John, notamment adaptées en bande dessinées à partir de 1990 chez Lefrancq, Miklo et Le Lombard, ainsi qu’en 44 épisodes de série télévisée de 30 minutes en 1960 et en un film en 1985.
*
Le texte original de W. E. (1932, Popular Flying magazine vol 1 numéro 1 et pour l’éditeur John Hamilton Ltd)
Lingfield, 1932.
The word ʿHunʾ, as used in this book, was the common generic term for anything belonging to the enemy. It was used in a familiar sense, rather than derogatory. Witness the fact that in the R.F.C. a hun was also a pupil at flying training school.
W.E.J.
Chapter 1
The White Fokker
To the casual observer, the attitude of the little group of pilots clustered around the entrance of B Flight hangar was one of complete nonchalance. MacLaren, still wearing the tartans and glengarry of his regiment,* a captain's stars on his sleeve, squatted uncomfortably on an upturned chock. To a student of detail the steady spiral of smoke from the quickly-drawn cigarette, lighted before the last half was consumed, gave the lie to his bored expression. Quinan, his ʿmaternityʾ tunic** flapping open at the throat, hands thrust deep into the pockets of his slacks, leaning carelessly against the flimsy structure of the temporary hangar, gnawed the end of a dead match with slow deliberation. Swayne, bareheaded, the left shoulder of his tunic as black as ink with burnt castor oil, seated on an empty oil drum, was nervously plucking little tufts of wool from the tops of his sheepskin boots. Bigglesworth, popularly known as Biggles, a slight, fair-haired, good-looking lad still in his teens, but an acting Flight-Commander, was talking, not of wine or women as novelists would have us believe, but of a new fusee spring for a Vickers*** gun which would speed it up another hundred rounds a minute.
His deep-set hazel eyes were never still and held a glint of yellow fire that somehow seemed out of place in a pale face upon which the strain of war, and sight of sudden death, had already graven little lines. His hands, small and delicate as a girl's, fidgeted continually with the tunic fastening at his throat. He had killed a man not six hours before. He had killed six men during the past month—or was it a year?—he had forgotten. Time had become curiously telescoped lately. What did it matter, anyway? He knew he had to die some time and had long ago ceased to worry about it. His careless attitude suggested complete indifference, but the irritating little falsetto laugh which continually punctuated his tale betrayed the frayed condition of his nerves.
From the dim depths of the hangar half a dozen tousledheaded ack-emmas**** watched their officers furtively as they pretended to work on a war-scarred Camel. One habit all ranks had in common: every few seconds their eyes would study the western horizon long and anxiously. A visiting pilot would have known at once that the evening patrol was overdue. As a matter of fact, it should have been in ten minutes before.
* Officers transferring from the army to the air corps were allowed to retain their previous regiment's uniform.
** Tunic with a flap across the front which fastened at the side, not in the middle.
*** Machine gun firing a continuous stream of bullets at one squeeze of the trigger.
**** Slang: Air Mechanics.
*
La traduction au plus proche
Lingfield, 1932.
Le mot ʿHunʾ, tel qu'il est utilisé dans ce livre, était le terme générique commun pour tout ce qui appartenait à l'ennemi. Il était utilisé dans un sens familier, plutôt que péjoratif. Témoin le fait que dans la R.F.C. un hun était aussi un élève de l'école de pilotage.
W.E.J.
Chapitre 1
Le Fokker blanc
Pour l'observateur occasionnel, l'attitude du petit groupe de pilotes agglutinés autour de l'entrée du hangar de l'escadrille B était d'une nonchalance totale. MacLaren, qui porte toujours le tartan et le glengarry de son régiment*, ainsi que les étoiles de capitaine sur sa manche, est accroupi sur une cale retournée. Pour un étudiant du détail, la spirale régulière de la fumée de la cigarette tirée rapidement, allumée avant que la dernière moitié ne soit consommée, faisait mentir son expression ennuyée. Quinan, sa tunique de ‘maternité’** ouverte à la gorge, les mains enfoncées profondément dans les poches de son pantalon, appuyé négligemment contre la structure fragile du hangar temporaire, rongeait l'extrémité d'une allumette morte avec une lente délibération. Swayne, tête nue, l'épaule gauche de sa tunique aussi noire que l'encre de l'huile de ricin brûlée, assis sur un baril de pétrole vide, arrachait nerveusement de petites touffes de laine du haut de ses bottes en peau de mouton. Bigglesworth, plus connu sous le nom de Biggles, un jeune homme mince, aux cheveux clairs et à l'allure agréable, encore adolescent, mais commandant de bord par intérim, parlait, non pas de vin ou de femmes comme les romanciers voudraient nous le faire croire, mais d'un nouveau ressort de fusée pour un canon Vickers*** qui lui permettrait de tirer cent cartouches de plus par minute.
Ses yeux noisette ne s'arrêtaient jamais et contenaient une lueur de feu jaune qui, d'une certaine façon, semblait déplacée dans un visage pâle sur lequel la tension de la guerre, et la vue de la mort soudaine, avaient déjà gravé de petites lignes. Ses mains, petites et délicates comme celles d'une jeune fille, s'agitaient continuellement autour de la tunique qui s'attachait à sa gorge. Il avait tué un homme moins de six heures auparavant. Il avait tué six hommes au cours du mois - ou de l'année - écoulé, il l'avait oublié. Le temps s'était curieusement télescopé ces derniers temps. Quelle importance, d'ailleurs ? Il savait qu'il devait mourir un jour ou l'autre et avait depuis longtemps cessé de s'en inquiéter. Son attitude insouciante suggérait une indifférence totale, mais le petit rire de fausset irritant qui ponctuait continuellement son récit trahissait l'état d'usure de ses nerfs.
Depuis les profondeurs sombres du hangar, une demi-douzaine d'ack-emmas**** aux cheveux ébouriffés observaient furtivement leurs officiers qui faisaient semblant de travailler sur un Camel endommagé par la guerre. Une habitude commune à tous les grades : toutes les quelques secondes, leurs yeux étudiaient longuement et anxieusement l'horizon ouest. Un pilote de passage aurait su immédiatement que la patrouille du soir était en retard. En fait, elle aurait dû arriver dix minutes plus tôt.
* Les officiers passant de l'armée de terre à l'armée de l'air étaient autorisés à conserver l'uniforme de leur ancien régiment.
** Tunique avec un rabat sur le devant qui se ferme sur le côté et non au milieu.
*** Mitrailleuse tirant un flot continu de balles en appuyant sur la gâchette.
**** Argot : Mécaniciens de l'air.
***
La traduction française pour ANANKE BE.
à venir.
***
- Détails
- Écrit par David Sicé

The Primevals (2024)
Traduction : les primordiaux.
Ne pas confondre avec la série télévisée de 2007.
Notez que ce film en projet en 1969, faisait la couverture du magazine Cinefantastic US en 1978, a été tourné en 1997 et seulement achevé grâce au soutien financier du public en 2023 après la mort du réalisateur David Allen en 1999.
Annoncé au USA au cinéma le 11 mars 2024.
De David Allen (également scénariste), sur un scénario de Randall William Cook ; avec Richard Joseph Paul, Juliet Mills, Leon Russom, Walker Brandt, Robert Cornthwaite.
Pour adultes et adolescents.
(presse, pastiche, monde perdu, invasion extraterrestre) Après qu'un Yéti a été tué par un groupe de Sherpas, une équipe de scientifiques universitaires se rend au Népal pour découvrir les origines de la créature. Avec l'aide d'un traqueur robuste, le groupe part du village Sherpa et, après une avalanche, découvre une terre primitive cachée peuplée de créatures préhistoriques, d'hominidés anciens et d'une espèce reptilienne extraterrestre.





***
Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à ce film.
***
